Les journées du patrimoine 2020 : « Patrimoine et éducation »

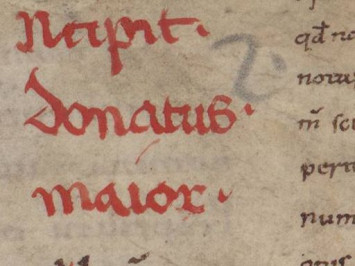
Cote : Ms 510
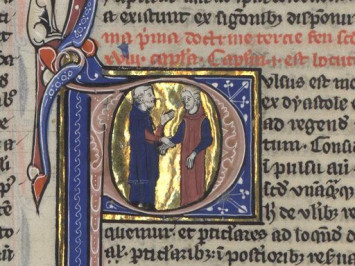
Cote : Ms 457

Cote : Ms 434
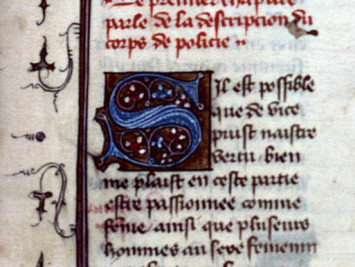
Cote : Ms 423
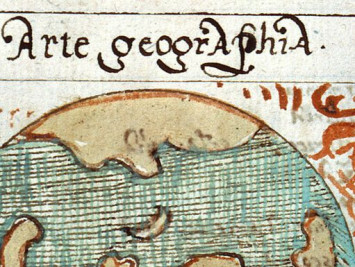
Cote : Ms 656

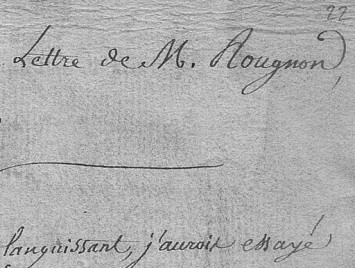
Cote : Ms Z 635
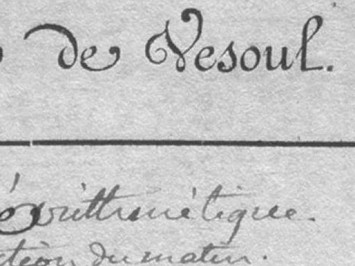
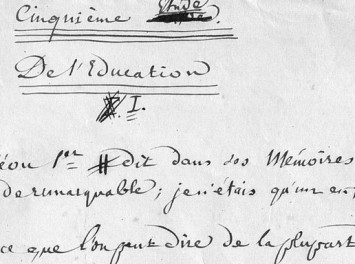
Cote : Ms 2850, f. 81-155