Besançon par Abel Monnot (2)

Cathédrale Saint-Jean
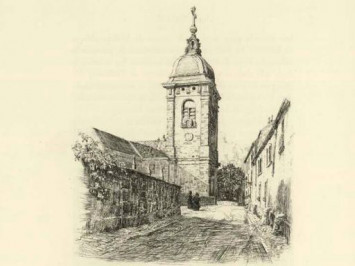
Clocher de la cathédrale
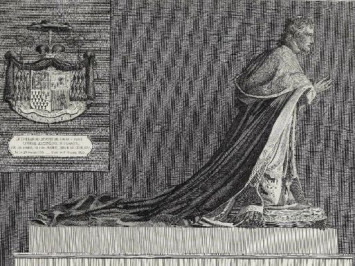
Monument funéraire de Louis-François-Auguste de Rohan-Chabot
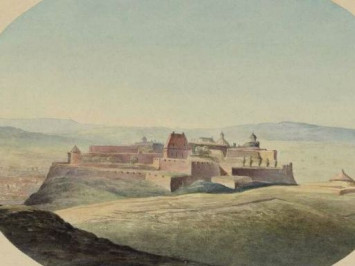
Vue de la Citadelle, par Marnotte

Une rue des faubourgs
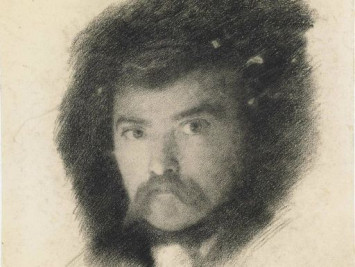
Jean Gigoux
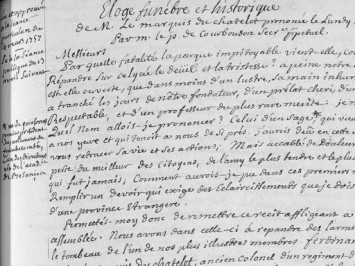
Éloge funèbre du marquis du Châtelet
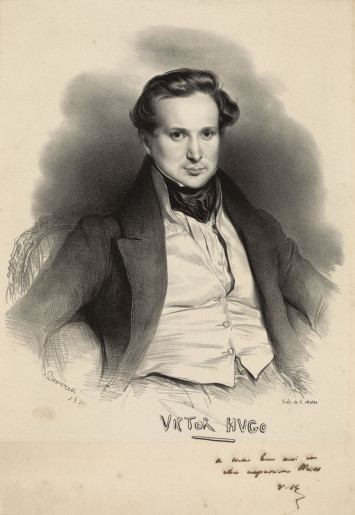
Victor Hugo
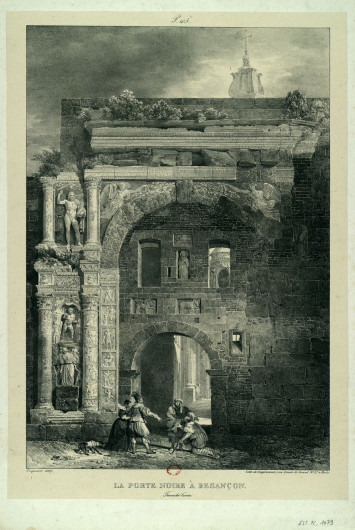
La Porte noire