Besançon par Abel Monnot (3)

Un dimanche à Besançon-les-Bains

Parlement (Palais de justice)


Apothéose de Mirabeau

Ecole Nationale d'Horlogerie.
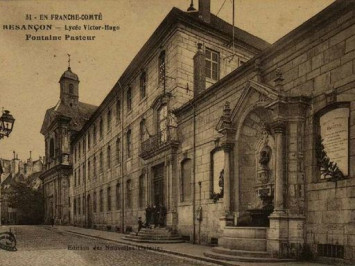
Lycée Victor-Hugo
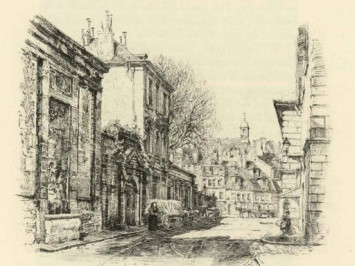
Fontaine des Clarisses et clocheton de Saint-François-Xavier
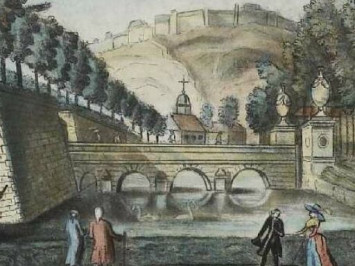
Pont de Chamars
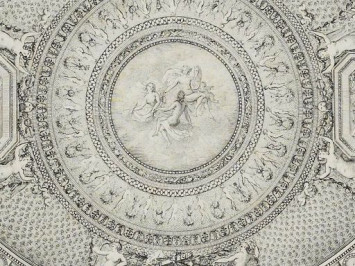
Plafond du théâtre
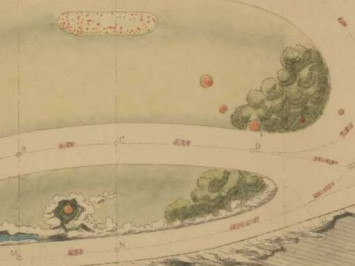
Fontaine de Billecul