Besançon par Abel Monnot (1)
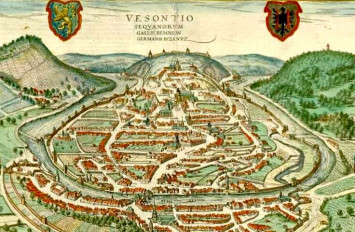
Vue cavalière de Besançon, dessinée par Pierre d'Argent

Les parapets du pont Battant
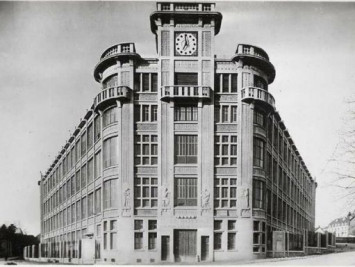
L'école d'horlogerie sans toits visibles

Photos Faille 1959
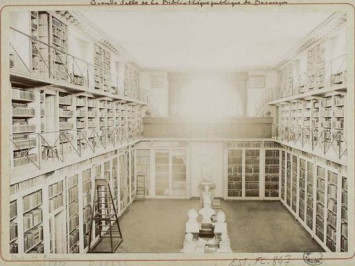
La bibliothèque de Besançon
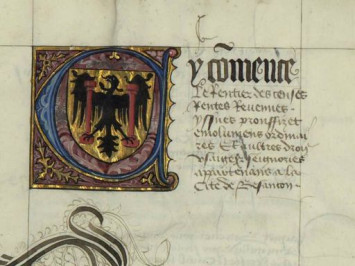
Les armes dans un livre de compte
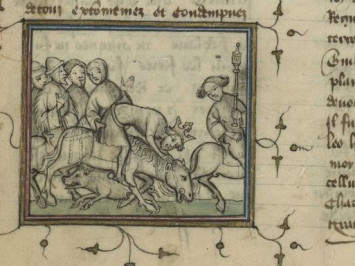
Ms 677 Le Roi tué par un cochon
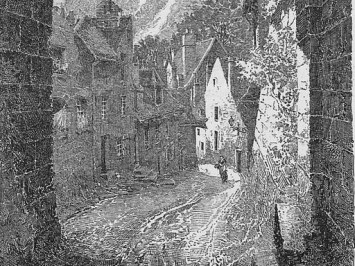
Mon Vieux Besançon de Gaston Coindre
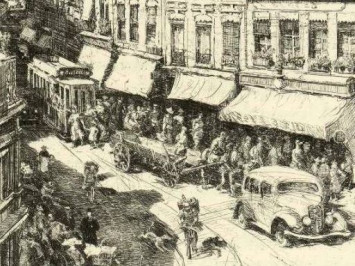
Charles Jouas
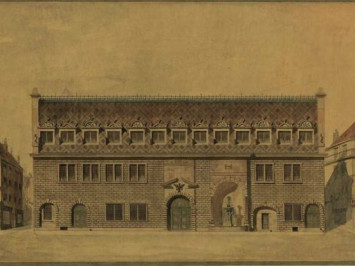
L'Hôtel de Ville
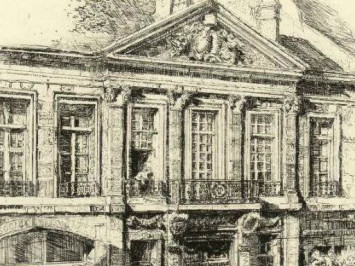
Charles Jouas

Les ancres de l'hôtel Pourcheresse de Fraisans
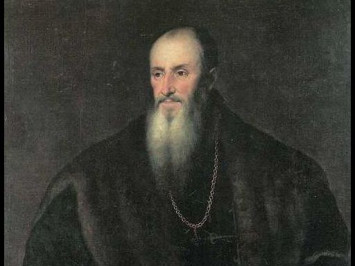
Nicolas de Granvelle par Titien

Un chromo Parmentier
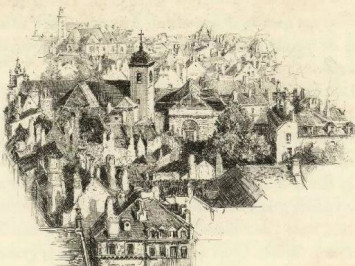
Charles Jouas